Construire une maison en briques, une allée en pavés ou un mur en parpaings, ce n’est pas qu’une affaire de technique. C’est aussi une question d’intention, de ressenti et d’histoires à raconter. Autant vous dire que vous êtes au bon endroit pour oser le choix qui vous ressemble. On vous le raconte dans notre article.
Briques, Pavés, Parpaings : La triade des fondations et des façades

La réponse courte pour les pressés : briques = confort & esthétique, pavés = extérieur & décor, parpaings = structure & budget
Pas de tour de chauffe. Ici, on attaque direct à la truelle : brique, pavé ou parpaing, chacun a son terrain de jeu et ses humeurs. Sur le chantier, c’est comme dans une équipe de foot amateur du dimanche matin—y’a toujours le frimeur (la brique), le discret qui fait tout le sale boulot (le parpaing), et l’artiste imprévisible (le pavé).
Le choix du matériau ? C’est pas juste une histoire de fiche technique ou d’avis de tonton Maurice. Non. C’est aussi une question de flair, celui qui fait qu’on préfère une pierre qui « chante sous le marteau » à un bloc sans âme. Un vieux maçon vous dirait que ça se sent autant que ça se calcule—et il aurait raison !
Allez, pour ceux qui veulent la synthèse express avant de filer planter des clous dans leur bazar végétal :
- La brique ? Le cocon douillet qui isole du froid et claque sous le soleil comme un mur d’Italie.
- Le pavé ? Le tapis de jeu extérieur qui résiste au passage du temps (et des pneus !) sans broncher.
- Le parpaing ? Le costaud sans fard, bourru mais fiable, pour ériger vite fait bien fait ce qui doit tenir debout sans faire lever les foules.
Résumé clé
Brique : confort, isolation, joli minois — Pavé : résistance dehors et style — Parpaing : structure béton et tarif serré.
Comprendre l'intention derrière le choix : quel matériau pour quelle mission
Soyons honnêtes : Si vous pensez que choisir entre brique, pavé ou parpaing c’est juste cocher une case sur un devis… repassez demain. Chaque matériau a sa mission sacrée :
- Le parpaing, c’est le squelette du bâtiment – il encaisse tout sans broncher. Vous voulez monter un garage en quatre week-ends avec la même efficacité qu’un café soluble ? Parpaing. Mais attention au look brut façon bunker soviétique…
- La brique, elle habille le corps « avec style et chaleur ». On l’utilise quand on veut un mur qui respire la belle ouvrage, qui garde la chaleur l’hiver mais laisse circuler l’air l’été. Pas mal pour ceux qui rêvent d’une maison à vivre plus qu’à exposer sur Instagram.
- Et enfin le pavé—ce n’est pas un comparse secondaire ! Il pave la route des retrouvailles familiales sur la terrasse ou mène doucement vers un potager anarchique où rien ne pousse droit mais tout finit par donner du goût.
Vous avez déjà essayé de poser une terrasse en parpaing ou bâtir votre salon en pavés ? Spoiler : ça ne marche jamais du premier coup…
Pour ceux dont l’intuition s’arrête là où commence la technique : mieux vaut connaître les secrets d'un mortier bien dosé avant d’aller plus loin !
Un petit tour des matériaux : brique (terre cuite), pavé (pierre, béton, terre cuite), parpaing (béton)
Alors… parlons cuisine—façon maçon, pas chef étoilé.
- La brique est faite d’argile moulée puis cuite (autant vous dire que ça sort pas du four micro-ondes…). Elle existe en version pleine ou creuse ; certains collectionnent les modèles comme d’autres les capsules de bière — allez comprendre !
- Le pavé, lui, vient dans tous ses états : pierre naturelle sortie brute comme un galet nerveux ; béton sculpté à coups de moule industriel ; ou bien terre cuite récalcitrante à faire rentrer au cordeau quand il fait trop chaud.
- Et enfin le parpaing, c’est tout simplement du béton coulé dans des moules—granulats divers (sable ou gravier) + ciment + eau = bloc prêt à encaisser toutes vos envies (ou vos erreurs).
Soyons honnêtes encore une fois : aucun n’a été conçu pour faire rêver les poètes mais chacun sait tailler court à la routine architecturale…
Composants principaux pour briller en société :
- Brique : argile cuite
- Pavé : pierre naturelle / béton / terre cuite
- Parpaing : béton (ciment + granulats + sable)
Le parpaing : le dur à cuir du gros œuvre, sans chichis

Qu'est-ce qu'un parpaing ? La recette du bloc béton
Le parpaing, c’est le gros bras de la construction – le genre à ne pas moufter même sous la pluie ou quand une visseuse récalcitrante décide de vous gâcher la journée !
Côté recette ? Aucune surprise de grand chef : 87 % de granulats (sable, gravier, gravillons), 7 % de ciment, une larme d’eau (environ 6 %) et basta. On mélange tout ça dans un moule bien carré et on obtient un bloc aussi discret qu’essentiel. Autant vous dire que le raffinement n’est pas son problème principal… Sa texture poreuse, sa couleur grise tristounette : c’est brut de décoffrage, mais diablement efficace.
Anecdote à sortir en apéro pour briller : certains anciens appellent encore le parpaing « moellon industriel » histoire d’embrouiller les débutants ou d’avoir l’air plus savant que le voisin.
Les super-pouvoirs du parpaing : résistance, rapidité, petit prix
Il faut lui reconnaître ses atouts – ça encaisse les coups comme un vieux boxeur qui a roulé sa bosse sur tous les rings. Résistance mécanique élevée : tempêtes, tassements du terrain ou ratés de niveau à bulle, tout glisse dessus ! Sa pose ? Ultra-maîtrisée : spoiler ! On monte un mur plus vite que son ombre (ou presque). Et pour ce qui est du budget… pas besoin de vendre un rein ni même un vieux vélo – c’est le prix plancher assuré.
👍👍👍 pour la résistance structurelle et le budget
Anecdote qui pique : lors d’un chantier express en 2017, on a bâti un local technique entier en deux jours chrono, pause café comprise. Aucun autre matériau n’aurait accepté ce rythme sans broncher (ni se fissurer).
Les limites du parpaing : isolation, esthétique brute, finitions
Mais attention ! Le parpaing a ses faiblesses. Son côté « mauvais élève » en isolation thermique mérite d’être noté au tableau rouge – à nu, il laisse filer la chaleur comme une fenêtre ouverte chez mamie quand elle surveille son potager anarchique. Côté gueule ? C’est brut et ça suinte rarement le charme. Faut recouvrir (enduit, isolant), sinon votre salon ressemblera à une salle d’archive municipale… Vous avez déjà essayé de faire une fête dans un mur de parpaings ? Bof…
Quand le parpaing s'impose : murs porteurs, fondations, cloisons basiques
Le roi des murs costauds et des projets où il faut plus de carrure que de flonflons décoratifs. Le parpaing a ses terrains fétiches :
- Murs porteurs : là où ça doit tenir le poids des ans (et des étagères surchargées), il répond toujours présent !
- Fondations : le socle sur lequel repose tout votre rêve immobilier – si ça ne tient pas là-dessous… autant planter des clous dans de la mousse !
- Cloisons basiques : pour séparer votre bazar végétal du coin bricolage ou créer une cave digne d’une scène culte avec Gérard Depardieu…
Soyons honnêtes : ceux qui cherchent poésie ou effet waouh passeront leur chemin — ici c’est efficacité avant tout. Mais avouez qu’il a une sacrée âme ce vieux bloc gris !
La brique : la star du confort thermique et de l'élégance
La brique sous toutes ses formes : de la terre cuite à la monomur, en passant par la creuse
On ne va pas tourner autour du tas de sable : la brique, c’est la diva du chantier. Un vrai casting familial où chaque modèle a son grain et sa spécialité – un peu comme dans les repas du dimanche où tatie Josiane veut toujours avoir le dernier mot.
Voici le casting des sœurs brique :
- Brique pleine : le mastodonte traditionnel. Dense, lourde, increvable – parfaite pour les murs porteurs qui veulent traverser les siècles (et les humeurs des locataires). Elle absorbe bien l’humidité et encaisse sans broncher.
- Brique creuse : plus légère, plus économique et surtout pose rapide. Idéale pour monter des cloisons ou habiller un mur sans jouer à Hulk.
- Brique perforée : on dirait une brique suisse… Les trous allègent le poids mais aussi améliorent les performances thermiques. On la retrouve souvent dans les constructions modernes qui veulent marier isolation et légèreté.
- Brique monomur : XXL et multifonction ! Épaisse, bardée de cavités savamment réparties, elle assure isolation thermique ET structure porteuse d’un seul tenant. Autant vous dire que si vous voulez tout faire d’un coup (et éviter de multiplier les couches comme un millefeuille), c’est elle qu’il vous faut.
Résumé express pour briller au prochain barbecue :
Pleine = robustesse, creuse = rapidité, perforée = isolation boostée, monomur = tout-en-un.
Choisir une brique n’est pas si simple : vous êtes bons pour revoir vos préjugés !
Les atouts de la brique : isolation performante, inertie thermique, respiration des murs, esthétique naturelle
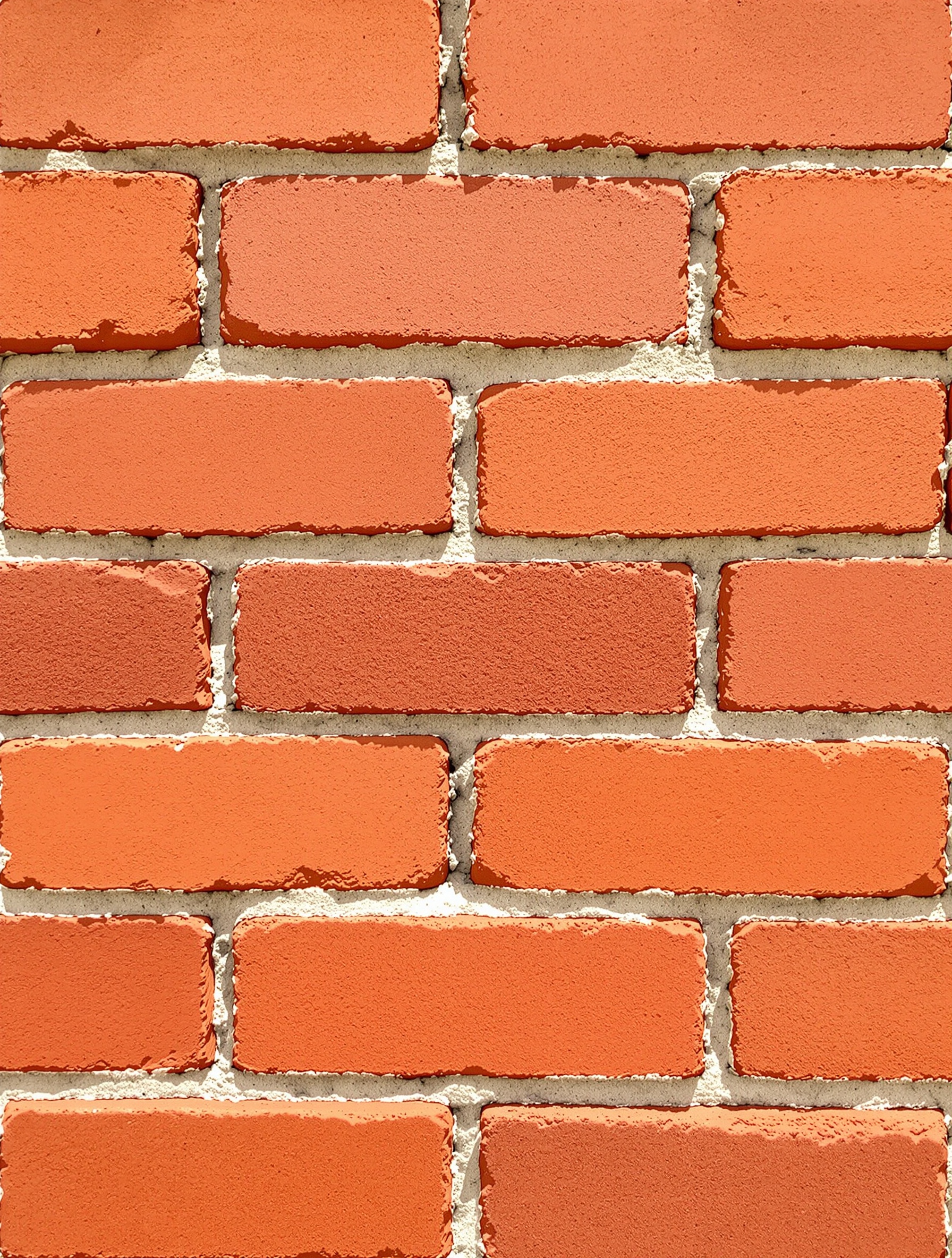
Autant vous dire que côté charme, aucun parpaing n’arrive même à faire trembler une demi-jointure de brique... Voici ce que la star du lot propose :
- Isolation thermique naturelle : la brique emmagasine la chaleur en journée et la restitue pendant la nuit – fini les montagnes russes côté température !
- Inertie thermique : elle agit comme un gilet pare-balles contre le chaud ET le froid. Vous avez déjà dormi dans une maison en brique au mois d’août ? Essayez donc avec un mur en béton brut…
- Respiration des murs : contrairement au parpaing – qui fait parfois office de bâche plastique – la brique laisse circuler l’air. Résultat : moins d’humidité stagnante et une qualité de l’air intérieur qui sent bon le vrai.
- Esthétique chaleureuse : oubliez les murs ternes façon salle d’attente. Un mur en briques apparentes donne immédiatement une ambiance vivante (et avouez-le, ça impressionne toujours belle-maman).
- Matériau vivant : ce n’est pas juste un bloc posé là – ça évolue dans le temps, ça prend une patine unique selon votre histoire… Ceux qui savent « écouter » leurs murs savent de quoi je parle !
Les briques, ça coûte ? Le prix à payer pour le confort et le style
On va pas se mentir : vouloir construire en brique alors qu’on a le budget d’un abri à vélos en tôle ondulée… erreur classique !! Soyons honnêtes : entre bâtir son château ou son cabanon à outils, y’a un gouffre financier aussi large que l’écart entre une truelle propre et celle qui sort d’une piscine de ciment séché.
| Matériau | Prix indicatif par m² (mur monté)* | Prix par unité* |
|---|---|---|
| Brique | 30 € à 160 € | 0,50 € à 2 € |
| Parpaing | 20 € à 60 € | 1 € à 1,50 € |
*Les prix varient selon le type de brique/parpaing choisi (monomur = plus cher ; creuse/perforée = moins coûteuse). Source : marché matériaux 2024.
Autant vous dire que pour "faire sensation" sur votre façade ou garantir un confort d’hiver digne d’une couette neuve… il faudra allonger quelques billets supplémentaires. Mais quelle satisfaction après !
Où la brique fait merveille : maisons individuelles, façades de caractère, murs intérieurs chaleureux
Le terrain privilégié pour cette reine du chantier ? Là où on cherche chaleur humaine et cachet durable. Quelques utilisations qui valent leur pesant de terre cuite :
- Maisons individuelles : Pour ceux qui rêvent d’un nid douillet où il fait bon vivre même quand dehors souffle une tramontane carabinée…
- Façades : Vous voulez que votre maison ait de l’allure dès le trottoir ? Aucun crépi triste ne rivalisera avec une façade en belles briques apparentes.
- Murs intérieurs : Créer une ambiance loft ou campagne chic chez soi ? Rien ne vaut un pan de mur en brique nue pour donner vie à un salon ou réchauffer une chambre froide comme un frigo vide.
- Anecdote vécue : sur un chantier près d’Arras, j’ai vu un client changer tout son projet après avoir touché « sa première vraie brique monomur ». Résultat ? Une maison qui respire encore vingt ans plus tard — pas sûr qu’un parpaing aurait raconté autant d’histoires...
Bref : si vous cherchez juste "un mur", passez votre chemin... Mais si vous voulez un compagnon fidèle contre l’hiver (et parfois contre les modes), ne sous-estimez jamais cette bonne vieille brique !
Le pavé : le roi des extérieurs, habilleur d'allées et de terrasses

Le pavé, qu'est-ce que c'est ? Une brique de sol, en somme
On ne va pas vous faire un dessin (quoique…), le pavé c’est la "brique du sol". Sauf que celle-là ne se planque pas derrière une façade : elle s’expose volontairement aux caprices de la météo et au piétinement familial. Pluie, soleil ou passage du facteur pressé ? Il encaisse tout sans broncher, comme le doyen du quartier qui surveille sa rue depuis le même banc depuis 40 ans.
Le pavé, c’est aussi l’habilleur des extérieurs : il donne du style à votre allée, dessine la terrasse où on fait pousser la convivialité, et taille court aux mauvaises surprises du gazon boueux. Un tapis ? Oui… mais un tapis solide, fait pour marcher dessus, rouler dessus et même faire tomber les pots de fleurs quand le vent s’en mêle !
Les différentes familles de pavés : béton, pierre naturelle, terre cuite
Vous pensiez que tous les pavés racontaient la même histoire ? Spoiler : chaque tribu a ses secrets de fabrication et ses coups d’éclat sous la semelle !
- Pavés en béton : Les costauds polyvalents. Réguliers, colorables à volonté, ils encaissent tout (voire trop). On les croise partout parce qu’ils sont aussi dociles qu’une brouette bien graissée.
- Pavés en pierre naturelle : Les nobles intemporels. Granit ou grès tirés du sol : chaque pièce raconte une époque. Ils vieillissent sans se plaindre ni virer au kitsch ; leur patine a plus d’allure que certains salons design.
- Pavés en terre cuite : Les rustiques qui ont du caractère. Parfaits pour ceux qui veulent éviter la monotonie industrielle ; ils dégagent une chaleur et une vraie personnalité – attention au charme suranné !
Récap express des familles :
- Béton : régularité solide
- Pierre naturelle : cachet éternel
- Terre cuite : authenticité chaude
Les avantages du pavé : résistance à l'usure, esthétique modulable, drainage naturel (parfois)
Ici on ne vend pas du rêve, mais il faut reconnaître que le pavé a des talents cachés :
- Résistance à l’usure : vous pouvez y passer avec votre voiturette électrique ou inviter toute la famille pour un bal musette improvisé—ça ne bronche pas.
- Esthétique modulable à l’infini : couleurs, formats, motifs posés en damier ou façon labyrinthe… C’est le terrain de jeu idéal pour ceux qui veulent faire de leur allée une œuvre d’art et épater les voisins (ou déclencher leur jalousie).
- Drainage naturel (si posé correctement) : fini le potager anarchique après chaque pluie battante ! Les modèles drainants évitent les flaques éternelles et facilitent l’absorption dans le sol—pour peu qu’on respecte l’art de la pose…
👍👍 pour la polyvalence extérieure et l’esthétique personnalisable
Anecdote maison : sur un chantier pluvieux (comme toujours), on a vu des pavés poser moins de problèmes que certains invités un soir de réveillon... Preuve qu’avec eux on évite bien des drames hydrauliques !
Les contraintes du pavé : pose spécifique, entretien, coût variable
Avant de foncer tête baissée chez le marchand de matériaux pour acheter des palettes entières, sachez-le :
- La pose demande une méthode à l’ancienne. Pas question d’improviser avec trois bouts de ficelle ou d’espérer « faire pousser des clous » entre deux joints – spoiler : CHAQUE centimètre compte sinon c’est affaissement assuré.
- L’entretien n’est pas à oublier non plus... Entre les herbes folles qui poussent entre les joints (vous avez déjà essayé un désherbage intégral ? Spoiler bis : ça ne marche jamais du premier coup!) et les taches rebelles après quelques barbecues… il faut aimer retrousser ses manches.
- Le coût peut grimper selon le matériau choisi. Du béton basique au granit royal—l’écart n’est pas là pour rigoler… Soyons honnêtes : vouloir imiter Versailles avec un budget cabanon mène souvent à la déception !
Le terrain de jeu du pavé : allées carrossables, terrasses conviviales, bordures décoratives
On garde le meilleur pour la fin ! Où brille-t-il ce fameux pavé ?
- Allées carrossables ou piétonnes : c’est LE choix si vous voulez rouler/prendre l’apéro sans craindre le faux pas ni voir votre chemin fondre comme neige au printemps.
- Terrasses conviviales : là où poussent chaises longues et discussions interminables jusqu’à minuit passé.
- Bordures décoratives : marquer joliment la limite entre votre bazar végétal et ce qui reste vaguement sous contrôle dans votre jardin...
Vous vouliez donner une âme à vos extérieurs ? Pariez sur le bon cheval — enfin sur le bon pavé. Et rappelez-vous : ici chaque bloc porte sa propre histoire…
Comparatif pointu : briques, pavés et parpaings, lequel choisir pour votre projet ?
L'aspect financier : le bilan des comptes sans langue de bois
Pas la peine de sortir la calculette dernier cri : le parpaing reste l’imbattable du rayon « portefeuilles qui font la fête » ! On trouve des blocs standards entre 0,50€ et 1€, soit un prix au m² qui laisse de la place pour acheter un vrai marteau ou une visseuse moins récalcitrante. La brique, elle, prend un peu de hauteur : plus chère à l’unité (souvent entre 0,50€ et 2€), mais surtout côté pose où la main-d'œuvre fait grimper la note. Quant au pavé, c’est le caméléon du lot : selon que vous visez la terrasse en béton basique ou l’allée façon château médiéval en granit poli, là c’est votre portefeuille qui crie famine… ou souffle un peu si vous restez sur du béton ordinaire.
| Matériau | Prix indicatif / unité | Prix/m² (fourchette) |
|---|---|---|
| Parpaing | 0,50 à 1 € | 20 à 60 € |
| Brique | 0,50 à 2 € | 30 à 160 € |
| Pavé | 0,40 à >4 € | 15 à >100 €/m² |
Le pavé peut plomber ou sauver l’addition selon sa famille – ne négligez jamais une vraie comparaison avant de charger votre camion !
La performance technique : stats sans filtre
Ici, ça sent le banc d’essai et les murs testés par les hivers rudes. Parlons clair :
- Isolation : La brique mène la danse tel un plaid bien épais sur les genoux – performances thermiques hautes (jusqu’à R=4 m²K/W sur certains monomurs). Si vous cherchez à garder vos calories pour l’hiver plutôt que chauffer les moineaux dehors… inutile d’hésiter.
- Résistance mécanique : Le parpaing et le pavé se tirent la bourre. Un bon parpaing résiste sans broncher à une pression de plusieurs MPa ; il encaisse fondations et charges comme s’il avait fait l’armée. Les pavés supportent aussi très bien le passage répété (voitures, piétinement), parfois mieux que certains murs intérieurs fatigués…
- Usage : Faut-il rappeler qu’un pavé n’a rien à faire dans une cloison de salle de bain ? Et qu’un parpaing nu dehors vieillit comme une barrière d’entrepôt ? Soyons honnêtes : chaque matériau a sa mission sacrée.
Synthèse technique
Isolation : brique >> parpaing = pavé ; Résistance : parpaing ≈ pavé > brique (pour efforts purs).
L'esthétique : question de feeling... et d'audace ou pas
Alors là… terrain miné pour les indécis. La brique ? Elle a ce cachet qui parle tout seul même sale ou patinée – maison ancienne, loft branché ou rénovation stylée, elle ne trahit jamais un mur qui veut attirer l’œil. Le pavé, c’est « l’extérieur qui fait jaser les voisins » – couleurs infinies, motifs, il s’adapte au jardin anglais comme au parking carrossable chic… sauf si on rate l’alignement (et là bonjour le bazar végétal entre les joints) ! Le parpaing, lui, c’est la base discrète qu’on attend tous sous une couche d’enduit épais ou derrière un crépi inspiré. Il sait rester en retrait pour laisser parler ceux qui veulent briller devant.
Avis tranché d’artisan grognon mais honnête : vouloir « rendre beau » un mur nu en parpaings est rarement une brillante idée — misez sur la brique pour vos pièces maîtresses, et les pavés pour donner du relief dehors.
La mise en œuvre : chantier sans bobards
Côté sueur et organisation :
- Avec le parpaing, même le bricoleur pressé peut monter son abri bois avec deux bras valides et trois conseils glanés chez Greder. C’est facile à vivre.
- Pour la brique, demandez-vous si vous avez envie de pousser plus loin le goût du détail — car poser proprement demande doigté ET patience. Pose traditionnelle au mortier ou joints minces nouvelle génération… faut pas trembler des mains ni avoir oublié son niveau !
- Quant au pavé... alors là ! Poser des pavés c’est littéralement comme vouloir faire pousser des clous dans du sable mouillé : patience olympique obligatoire et savoir-faire indispensable si on veut éviter les affaissements disgracieux ou les flaques éternelles. Guide indispensable pour réussir vos allées
FAQ express : vos questions qui brûlent les lèvres
- Lequel choisir pour isoler vraiment ma maison ? Vous avez déjà essayé de chauffer une cabane en parpaing nu ? Prenez la brique monomur – isolation naturelle sans prise de tête.
- Si je veux juste bâtir vite et pas cher ? Parpaing direct ! Mais prévoyez une bonne couche finale sinon effet parking assuré.
- Et dehors ? Pavé béton si petit budget ; pierre naturelle si portefeuille prêt à pleurer mais jardin prêt à briller.
- Est-ce que ça vieillit bien ? Une façade en brique prend du caractère avec l’âge (si entretenue). Un pavage doit être suivi sinon herbes folles garanties ! Le parpaing préfère rester caché sous enduit tout au long de sa vie...
- On peut mixer ? Oui… mais attention aux mariages malheureux. Rien n’empêche une maison en brique avec terrasse en pavés – tant que chacun reste à sa place dans cette drôle de famille !
Bâtir avec intelligence : conseils et bonnes pratiques

Construire juste et beau : le dernier mot d’un vrai choix
On ne va pas tourner autour du plot de chantier : le matériau, c’est votre signature. Oui, il y a la technique – résistance, isolation, budget – mais soyons honnêtes, le vrai artisan écoute aussi son intuition. Un choix qui se fait à l’oreille du cœur, pas seulement au mètre ruban ou au devis de chantier.
Brique, pavé, parpaing… chacun porte une âme et une histoire. Ce n’est pas pour rien que certains murs traversent les siècles pendant que d'autres s’effritent dès la première gelée !
« Bien choisir ses matériaux, c’est offrir à sa maison une âme et une durée que même le temps respecte. Un vieux mur bien bâti ne raconte jamais la même histoire que ses voisins mal montés. »
Alors, avant de foncer tête baissée acheter douze palettes en promo chez le marchand du coin… Posez-vous deux minutes : qu’attendez-vous vraiment de votre mur ? Est-ce un simple abri contre la pluie ou un morceau de votre identité ? Le bon matériau est celui qui sait tailler court à la routine pour correspondre à votre projet ET à votre philosophie.
Le secret d’une bâtisse réussie ? Ne pas faire confiance au hasard ou aux modes éphémères. Construire juste et beau, c’est savoir écouter son chantier comme on écoute son jardin pousser — sans jamais chercher à faire pousser des clous dans du vent !
Les bonnes pratiques du maçon philosophe : pour un chantier qui tient debout et longtemps
Quand on parle durabilité et vraie robustesse, il vaut mieux s’inspirer d’un vieux mur de pierres sèches que d’une cloison montée à la va-vite entre deux cafés ! Qui veut bâtir solide suit quelques règles simples :
- Vérifier la qualité des matériaux avant toute chose (non, tous les lots pas chers n’ont pas été bénis par Saint-Béton)
- Planifier chaque étape de pose, quitte à passer pour un pinailleur – mieux vaut trop prévoir qu’avoir à tout refaire sous la pluie
- Prendre en compte l’environnement : orientation du soleil, humidité locale… vous avez déjà vu un mur nord sans mousse chez vos grands-parents ?
- Respecter les délais de séchage et stabilisation afin d’éviter fissures ou tassements prématurés (ça ne pardonne jamais)
- Ne jamais négliger l’entretien régulier. Même un mur de caractère finit par fatiguer si on le laisse bouffer par le lierre ou l’humidité rampante
- Demander conseil si doute, plutôt que « faire pousser des clous » sans mode d’emploi – personne n’a jamais eu honte d’apprendre sur le tas !
Bref… bâtir avec intelligence, c’est refuser les raccourcis idiots. C’est donner à chaque bloc sa place réelle dans l’histoire du chantier – et parfois accepter qu’un vieux parement patiné en dise plus long sur vous qu’un crépi dernier cri.





